Après 31 ans et 552 titres parus, les Editions Luce Wilquin cessent leurs activités ce 31 juillet 2019, alors que la maison d’édition se porte au mieux. En effet, seuls des problèmes de santé dans le chef de sa fondatrice expliquent ce choix difficile. Une satisfaction toutefois : après Geneviève Damas, Véronique Bergen, Kenan Görgün, Emmanuelle Favier, Laure Mi Hyun Croset, Valérie Nimal et Valérie Cohen, vous allez retrouver prochainement chez des éditeurs prestigieux nombre des auteurs découverts par les Editions Luce Wilquin, et ceci pour leur nouveauté ou la version en poche de titres publiés ici. Soyez donc attentifs à l’actualité de Mathilde Alet, Isabelle Bary, Alain Lallemand, Michel Claise, notamment.
Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés au long de ces 31 années. Merci aux diffuseurs/distributeurs qui ont défendu nos livres, aux libraires qui ont cru en nous, aux bibliothécaires qui ont accueilli nos auteurs pour des rencontres, aux salons du livre et festivals qui les ont invités. Merci aux blogueurs (blogueuses) pour leur enthousiasme. Et surtout merci à nos lecteurs fidèles !
Archives de l’auteur : luce
La Porte des Lions – Michel Claise

Sméraldine
14 x 20,5 cm, 288 pages
ISBN 978-2-88253-551-1
EUR 20.-
S’il fallait un symbole pour figer un instant l’incroyable destinée de Heinrich Schliemann, ce serait incontestablement le moment où il franchit la porte majestueuse des ruines de Mycènes menant au palais sanglant des Atrides – une porte surmontée par deux lions qui s’affrontent de part et d’autre d’un pilier sacré reposant sur un autel –, tel Agamemnon de retour de la guerre de Troie, avant qu’il soit assassiné par Égisthe, l’amant de la reine Clytemnestre. C’est la raison du choix du titre de ce roman qui a l’ambition de transformer en personnage de fiction cette personnalité hors du commun, comme le XIXe siècle, celui des grands aventuriers, a su en livrer à l’histoire du monde.
Michel Claise est un juge d’instruction connu pour son combat contre la criminalité financière et en charge des dossiers belges les plus chauds dans ce domaine. Après avoir rendu hommage dans Cobre (cuivre) aux héros chiliens de 1973 et dénoncé les exactions commises par un pouvoir absolu sans respect des libertés et des droits de l’homme, il s’empare dans son neuvième roman de la personne de l’homme d’affaires et archéologue Heinrich Schliemann pour en faire le pendant dix-neuviémiste d’Agamemnon.
En librairie
Les premières lignes
Les deux enfants se tenaient la main comme ils avaient vu les adultes le faire, assis sur la berge de l’étang proche du village d’Ankershagen, où ils habitaient tous deux. Ils fixaient la surface lisse des eaux stagnantes, troublées parfois par l’effleurement des ailes d’une libellule aventureuse ou par une grenouille qui, se prélassant sur une feuille de nénuphar, se décidait soudain à bondir pour attraper un insecte imprudent. Rien n’aurait pu détourner leur attention, pas même les mouches d’été qui se posaient obstinément sur leur visage.
« Tu crois qu’elle est venue hier ? demanda Minna, se rapprochant du garçon qui occupait toutes ses pensées.
– J’en suis certain », répondit Heinrich, qui frissonna de la sentir si proche.
« Elle », c’était la princesse mystérieuse qui vivait dans les eaux de l’étang et qui, quand c’était la pleine lune, en sortait à minuit, une coupe d’argent à la main, pour faire boire au passant surpris un peu de nectar magique fermenté dans les profondeurs de la Terre. Des histoires comme celles-là pullulaient dans la région comme moustiques en été, chaque arbre ayant son fantôme, chaque pièce du château abandonné son passage secret, chaque cimetière son trésor enfoui. Heinrich Schliemann, le fils du pasteur, n’avait pas son pareil pour récolter toutes les légendes des environs, qu’il racontait à ses condisciples dans la cour de l’école. Déjà que cet élève surdoué agaçait les gamins de son âge par sa mémoire et sa curiosité, mais en plus, quand il s’enflammait en évoquant ces histoires fantastiques et terrifiantes, il en arrivait à les effrayer au point de les faire pleurer, car ils finissaient, comme lui, à y croire dur comme le fer de l’épée d’un chevalier teutonique. Alors, ses condisciples lui tournait le dos, comme dans toutes les communautés quand quelqu’un dérange par sa différence. Sauf Minna, qui restait des heures pendue à ses lèvres, fascinée tant par la magie des récits que par celui qui les dévoilait comme personne. La gamine était la fille d’un riche fermier, monsieur Meincke, qui exploitait plusieurs pâturages autour du village. La famille de Heinrich était pauvre, et faire bouillir la marmite tenait chaque jour de l’épreuve chez les Schliemann.
« Heinrich, et si une nuit elle surgissait devant toi et te tendait sa coupe d’argent, qu’est-ce que tu ferais ? »
Le garçon ne répondit pas, mais il avait la réponse en lui : « J’essaierais de la lui voler ».
Le tiers sauvage – Aliénor Debrocq
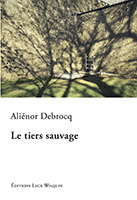
Sméraldine
14 x 20,5 cm, 320 pages
ISBN 978-2-88253-552-8
EUR 21.-
Pour Clara Clossant, trente ans, née le jour de la catastrophe de Tchernobyl, la vie est trouée de toutes parts. Croyant fermement au pouvoir des histoires, elle est persuadée que si l’on tombe dans le bon trou, celui de la fiction, il se peut qu’on ait une seconde chance, qu’on puisse battre les cartes une nouvelle fois. C’est ce qui lui arrive lorsqu’elle croise la route de Marcus Klein, auteur à succès récemment débarqué de Paris à Bruxelles. Agacée par sa popularité, elle décide de mener son enquête pour en faire un roman. Mais les livres qu’on imagine sont rarement ceux que l’on écrit et, bientôt, l’intrigue se déforme sous ses yeux sans qu’elle puisse contrôler ce qui se glisse dans les interstices entre le réel et la fiction.
Née à Mons (Belgique) en 1983, docteure en Art et Histoire, Aliénor Debrocq vit à Bruxelles où elle est journaliste, professeure de littérature et maman de deux petites filles. L’écriture de fiction donne sens à sa vie dès l’adolescence. Depuis 2013, elle a bénéficié de plusieurs bourses et résidences, publié deux recueils de nouvelles aux Éditions Quadrature et reçu le Prix Franz De Wever 2017 de l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique.
En librairie le 13 septembre 2018
Les premières lignes
C’est suite au succès de son troisième roman que Marcus Klein a quitté Paris pour Bruxelles, déposant ses valises au dernier étage d’une ancienne imprimerie forestoise située rue du Charme – une courte venelle pentue à sens unique menant au parc Duden, le long de laquelle, le dimanche, les enfants du quartier se laissent glisser à trottinette en piaillant, jusqu’au croisement avec une avenue fréquentée dont j’ai oublié le nom. Les deux autres étages du bâtiment sont occupés l’un par un bureau d’architectes, l’autre par une équipe de graphistes. Une écrasante majorité d’hommes blancs, la petite quarantaine dissimulée sous un jeans taille basse et un sweatshirt à capuche. Le standard d’aujourd’hui dans le monde des créatifs. Est-ce cela qui a séduit Marcus Klein le jour où il a pénétré dans la cour pavée de l’imprimerie en compagnie d’un agent immobilier dont le complet-veston anthracite détonnait au milieu des t-shirts bariolés des graphistes sortis prendre l’air, le temps d’une pause clope et café ? Est-ce réellement cette effervescence, ce bourdonnement, cette activité incessante régnant au milieu du calme souverain de cette impasse bucolique située à un jet de pierre de la gare du Midi, du parvis de Saint-Gilles et du centre-ville ?
Les dix-sept valises – Isabelle Bary

Sméraldine
14 x 20,5 cm, 192 pages
ISBN 978-2-88253-550-4
EUR 19.-
Alicia Zitouni est le genre de femme qui a tout pour aller mal. D’origine marocaine, elle est née en Belgique, mais ne se sent ni d’ici ni de là-bas. Elle sillonne une vie chahutée et marquée au fer rouge par un environnement violent, enfermant, acculturé et soumis au diktat des hommes. Pourtant, Alicia rayonne. Elle transpire cet enchantement pour la vie qui permet de la traverser les bras grand ouverts, quel que soit le cadeau de naissance.
Lorsque Mathilde Lambert – jeune femme moderne qui a tout pour aller bien – décide d’écrire un roman inspiré par le destin étonnant d’Alicia, elle est loin d’imaginer que ce projet va bouleverser sa vie.
En se glissant dans la peau de son héroïne, elle découvrira, au bout de sa propre plume, une manière d’appréhender l’existence aux antipodes de la sienne. Elle pénétrera les mondes invisibles des croyances et de l’imaginaire, et se laissera porter par la grâce d’envisager le monde avec poésie. Elle comprendra enfin pourquoi, d’elles deux, c’est Alicia qui souriait le mieux.
Isabelle Bary tisse, dans son dixième livre, le portrait d’une femme aux origines métissées et au lourd passé qui gagne sa liberté en posant un regard particulier sur les choses de la vie. Elle a ce pouvoir de transformer les fardeaux de son existence en cadeaux. Et si nous étions tous dotés de cette force-là ?
En librairie le 13 septembre 2018
Les premières lignes
4 septembre 2018Son vélo est posé sur la dune qui domine la plage. De loin, on dirait qu’il flotte dans le ciel. Je souris, fière d’avoir deviné ses intentions matinales. Je range mon scooter à l’abri du vent qui brise le silence de l’aube, puis j’emprunte le sentier qui mène à la crique, en contrebas. Elle a dû dévaler adroitement les rochers, la descente est délicate, mais pas redoutable. À mi-parcours, j’aperçois sa serviette étendue sur le sable sous un tas de vêtements. La plage est déserte. Je détaille ses nippes jetées en boule, elle a tout ôté. Tout cela présage la baignade. Pourtant personne ne flotte sur la mer. Une, trois, six minutes, Alicia ne réapparaît pas.
Je suis arrivée à Essaouira la veille. J’avais réservé une place à l’avant de l’avion, rangée 6, côté hublot. Voir la terre, puis le bleu du ciel juste après l’inconfort des nuages me rassure. J’ai rangé mon sac sous le siège devant et glissé mon paquet de mouchoirs, mon bouquin et mes mandalas à colorier dans la pochette en treillis où se trouvent les consignes de sécurité. Puis, mes écouteurs vissés sur les oreilles, j’ai regardé le flot des gens qui s’engouffraient un peu sauvagement dans l’appareil. J’ai hésité entre avaler une nouvelle salve de gouttes de Fleurs de Bach ou prendre le cachet anxiolytique que m’avait recommandé mon médecin. L’avion ne tarderait pas à décoller et j’ai opté pour le verre de vin en vol. Quelques gorgées devraient suffire à me relaxer, même si au stress de l’avion s’est ajoutée l’excitation de rejoindre Alicia. Le steward a arpenté le couloir en vérifiant le bouclage des ceintures. La mienne était déjà abusivement serrée depuis l’instant où j’avais pris possession de mon siège. L’avion était sur le point de s’arracher du sol. Mon voisin a fermé les yeux. Je l’ai imité, pour ne plus penser ni à la terre, ni au ciel, ni à ma double agitation qui flottait entre les deux. Je n’ai plus pensé qu’à la plage qui m’attendait là-bas.
Miradie – Anne-Frédérique Rochat

Sméraldine
14 x 20,5 cm, 192 pages
ISBN 978-2-88253-548-1
EUR 19.-
Miradie a la curieuse sensation que sa peau s’affine durant la nuit, qu’elle en égare des minuscules particules, des tout petits bouts, mais pourquoi ne trouve-t-elle jamais, en s’agenouillant au pied de son lit et en scrutant ses draps, de preuves concrètes de ce dénuement ? Où disparaissent les morceaux de chair qu’elle a l’impression de perdre ?
Réceptionniste dans un hôtel trois-étoiles décati, Miradie tente, tant bien que mal, de répondre au téléphone, aux mails et aux mécontents avec le sourire, un sourire accueillant et naturel, mais parfois, en traversant le grand parc pour rentrer chez elle, elle a envie de crier, et elle crie, si la nuit est tombée et que personne ne se balade à proximité.
La comédienne suisse Anne-Frédérique Rochat, née en 1977 à Vevey, alterne écriture dramatique et narrative depuis quelques années, trouvant un plaisir différent, mais complémentaire, dans l’exercice de ces deux genres littéraires. En 2016, le Prix Littérature de la Fondation Vaudoise pour la Culture a couronné l’ensemble de son œuvre. Miradie est son septième roman.
En librairie le 16 août 2018 (le 23 août en Suisse)
Les premières lignes
Sa peau, jour après jour, semblait s’affiner, et la chair de poule beaucoup plus facilement lui venait, c’était ce qu’elle avait remarqué. Elle caressa son ventre et fut surprise, encore une fois, par la douceur de son épiderme. De la soie. Ce qui n’était pas désagréable (bien au contraire), mais n’était-ce pas un peu inquiétant de perdre ainsi, très discrètement, nuit après nuit, des minuscules particules de chair, des petits bouts de soi ? Elle se leva, s’agenouilla au pied du lit et scruta les draps : rien, aucune trace de ce dénuement. Probablement que ce qu’elle perdait (laissait ?) était invisible à l’œil nu. Elle alla s’habiller et s’ordonna de prendre rendez-vous chez un médecin pour s’assurer que ce curieux phénomène n’était pas le symptôme d’une maladie grave, voire mortelle.Assise à la table de la cuisine, elle buvait son café en regardant au-dehors, elle avait la chance d’avoir un grand parc juste devant chez elle ; de ses fenêtres, elle apercevait des arbres et des oiseaux, des écureuils même parfois, mais c’était plus rare.
Elle n’avait pas faim ce matin, elle avait essayé de manger une tranche de pain beurrée, sans parvenir à la terminer. Elle soufflait sur son café, il fallait toujours patienter avant de pouvoir en avaler une gorgée. Elle songea qu’elle devrait peut-être le préparer en sortant du lit, ainsi il aurait le temps de refroidir pendant qu’elle se doucherait, s’habillerait, se coifferait, et elle pourrait le boire plus rapidement. Mais dans ce cas, ne risquerait-il pas d’être trop froid ? Elle souffla encore, tenta de reprendre une gorgée, ça lui brûla la gorge. Elle se leva, alluma la radio, chercha une station avec de la musique, n’en trouva pas, c’était l’heure pile, l’heure des nouvelles et de toutes les atrocités dont l’humanité était capable, elle ne se sentait pas de taille à écouter des horreurs, avait besoin de calme et de douceur. Elle éteignit la radio. Souffla à nouveau sur son café. Son téléphone se mit à sonner. Elle le chercha un moment avant de le trouver entre les coussins du canapé. Sylvanna clignotait sur l’écran avec insistance.
« Bonjour, ma tante, comment allez-vous ?»
Ma place dans le circuit – Sabine Dormond

Euphémie
14 x 20,5 cm, 160 pages
ISBN 978-2-88253-549-8
EUR 16.-
C’est sans doute l’une des angoisses lancinantes de notre époque. Ou peut-être de tous les temps.
Trouver sa place dans le monde professionnel, quand la tendance est au dégraissage et à la déshumanisation des rapports. Quitte à écraser l’autre. Se profiler face à la concurrence, évincer les rivaux.
Trouver sa place dans une société de plus en plus clivée.
Trouver sa place quand on porte comme une tare la culpabilité d’un autre. Ou sur ses seules épaules le poids de la vérité.
Trouver sa place auprès de l’autre, jusqu’à se l’accaparer.
Trouver sa place quand la vie s’obstine à nous refuser le rôle convoité.
Et la foi, a-t-elle encore sa place dans un monde fanatiquement laïc ?
… si tout l’enjeu se résumait à ça ?
Quand elle ne traduit pas, Sabine Dormond écrit, surtout des nouvelles. L’écriture lui est prétexte à rassembler des gens : elle anime des ateliers et des débats, co-fonde en 2011 Les dissidents de la pleine lune, un café littéraire en pleine expansion, et préside pendant six ans l’Association Vaudoise des Écrivains. Sous la houlette de la Maison éclose, elle lit aussi ses textes à l’oreille des curieux dans des décors somptueux et des lieux improbables.
En librairie le 16 août 2018 (le 23 août en Suisse)
Les premières lignes
On n’est encore, pour une heure, que le vingt-trois du mois, et mon compte navigue déjà à l’orée du rouge. Le frigo a des allures de plaine morte et les provisions du buffet se résument à un paquet de spaghetti entamé et à une boîte de thon datant de l’époque où je pouvais m’offrir le luxe de laisser passer une date de péremption. Je n’ai le courage ni de l’ouvrir, ni de la jeter. Malgré l’état de mes finances, un crochet au Magasin du Futur s’impose. Je me gare tout près de l’entrée, sur l’immense parking désert. Oui, je fais partie de ceux qui achètent de l’essence quand ils n’ont plus les moyens de s’offrir une scarole, il faut habiter Montrou pour comprendre que la mobilité puisse être une absolue priorité. Je glisse ma carte de fidélité dans la fente et la porte coulisse. À passé vingt-trois heures dans un bled pourri qui n’a qu’un vieux troquet, un bowling et une chorale à offrir pour tout divertissement, le supermarché est ouvert, comme n’importe quel autre jour de la semaine, dimanche inclus. Parce que le Magasin du Futur n’est pas un supermarché comme un autre. Et que les syndicats seraient bien en peine d’y trouver à redire.
Les yeux rivés sur l’écran tactile, je suis en train de passer en revue les gammes d’articles correspondant à mon budget dans cet assortiment vertigineux quand la porte vitrée s’écarte à nouveau. Deux clients coup sur coup, voilà qui n’est pas banal à une heure aussi tardive. Je tourne la tête pour voir si c’est quelqu’un que je connais, et la surprise me cloue sur place. La dame qui vient de faire irruption est sapée comme la reine d’Angleterre. Tailleur chic, bijoux classe, sac Vuitton, chaussures Dolce & Gabana, foulard Hermès, accessoires de luxe dont chacun représente l’équivalent de mon salaire annuel.
Elle se dirige d’un pas assuré vers l’un des écrans, sélectionne un article et va le ramasser dans le bac. Un paquet de cigarettes mentholées. La simple vue de l’emballage me donne la nausée. J’ai horreur de ce chaud-froid, de ce répugnant contraste d’odeurs. Laissant la bourgeoise à ses addictions, je reprends mes courses où je les avais laissées quand je l’entends s’exclamer :
« Il n’y a personne ici ? »
Inutile de lui faire remarquer ma présence. À l’évidence, je ne suis pas ce qu’elle appelle quelqu’un. Elle détaille le local, ses yeux s’attardent autour de la porte. Étrangement, les battants ne se sont pas écartés sur son passage, comme ils le font habituellement dès qu’on s’avance dans la zone de sortie. Je m’en amuse un instant, avant de lui expliquer :
« Vous fatiguez pas à chercher un bouton à l’intérieur. La porte est censée s’ouvrir automatiquement dès que le système détecte une présence dans le périmètre.
– Et quand ça ne fonctionne pas ?
– Avant, il y avait un surveillant pour donner l’alerte. Mais il a été viré. »
Si près de l’aurore – Daniel Charneux

Sméraldine
14 x 20,5 cm, 352 pages
ISBN 978-2-88253-546-7
EUR 22.-
Parfois, un astronome découvre dans le ciel une petite planète. Il la nomme, la décrit, publie à son sujet. Elle n’avait jamais été remarquée, car elle se tenait dans l’ombre d’un astre qui l’éclipsait, mais elle était bien là, pareille, avec toute son histoire amorcée depuis la nuit des temps, ses ères géologiques, ses volcans, ses glaciations, son étrange et banal paysage de petite planète. Quelques mois après la disparition du jupitérien Henry VIII, la petite planète Jane Grey entrait dans la lumière. Car elle n’était rien moins que troisième dans l’ordre de succession.
À moins de quatorze ans, humaniste accomplie, Jane Grey amorce une correspondance en latin avec le réformateur suisse Heinrich Bullinger et lit Platon dans le texte grec. Et tout ça dans un cadre historique passionnant : la Renaissance, l’humanisme, l’Angleterre des Tudors…
Dans ce roman, Daniel Charneux conte l’histoire de cette jeune fille si brillante qui sera reine d’Angleterre durant neuf jours, devenant malgré elle l’enjeu d’une vaste et cruelle partie d’échecs.
Daniel Charneux donne ici son huitième roman, le sixième publié aux éditions Luce Wilquin. Ses écrits ont été primés ou remarqués par les jurés de nombreux prix littéraires, à l’image de Norma, roman, prix Charles Plisnier 2007, et de Nuage et eau, finaliste du prix Rossel en 2008.
En librairie le 31 mai 2018
Les premières lignes
En ce temps-là, Dieu était partout et toujours.
Dans les églises et les chapelles, dans les abbayes, dans les monastères, de matines à laudes, de vêpres à complies, des moines embusqués sous leur capuce et des chantres à bedon rond chantaient son nom.
Les oiseaux le louaient dans les parcs et les bois, et les poissons dans les ruisseaux et les rivières, et les cristaux dans chaque pierre ancrée en terre ou roulée, jour après jour depuis la nuit des temps, au lit des cours d’eau qui dessinent leur résille sur la carte d’Angleterre, comme sous la peau le bleu réseau des veines.
Il était de jour, il était de nuit, dans le disque pâle de la Lune, dans chaque étoile piquée sur le cachemire du ciel, dans la brume de la Voie Lactée qu’en ce temps-là, non envahi de lumières factices, vous auriez contemplée comme, aujourd’hui, vous ne l’admirez plus qu’en quelques déserts épargnés où Dieu s’est réfugié dans les replis du sable.
Il était dans l’œil de la biche et dans le raire du cerf, en cet automne de l’an 1537, au cœur de la vaste forêt de Charnwood où les grands ormes peu à peu se dépouillaient de leurs feuilles roussies. C’était octobre. Le 12, à Londres, deux mille coups de canon avaient ému le ciel, saluant la naissance d’un héritier royal, car il avait plu à Dieu de donner au roi Henry, huitième du nom, ce fils tant attendu qu’il baptiserait Edward et qui, quelque jour, perpétuerait la lignée des Tudors.
Le futur Edward VI vagissant dans sa bercelonnette, faiblement, gracilement, sa mère à ses côtés, Jane Seymour, la reine, sa mère épuisée, sa jeune maman primipare aux lèvres minces, aux joues rondes, blonde de poil et de peau, grelottant sous la sueur, servantes remuantes épongeant de lin blanc le sang épais qui lui poissait les jambes. Dans les intermittences de la fièvre, elle prierait Dieu ; les servantes aussi, et son mari le roi, et l’archevêque Cranmer, tous supplieraient ce Dieu qui ne ferait pour elle rien d’autre que la rappeler à lui, douze jours plus tard, et souffler à une autre mère ce prénom, Jane, pour la petite fille née quelques jours après Edward, à Bradgate House, dans le Leicestershire.
Seuls les échos de nos pas – Françoise Pirart

Sméraldine
14 x 20,5 cm, 208 pages
ISBN 978-2-88253-547-4
EUR 19.-
À Bruxelles, une jeune comédienne de talent, Coline, disparaît mystérieusement. Sa voiture est retrouvée sur un parking dans le Sud de la France.
Bouleversés par ce drame, son frère Gilles et sa meilleure amie Anaïs mènent l’enquête, chacun de leur côté.
Et, un jour, leurs chemins se croisent. C’est le début d’une aventure qui va les conduire jusqu’en Espagne, dans les Pyrénées. Là-bas, quelque part dans les montagnes, se trouve peut-être le secret de Coline.
Amitié inaltérable, soif d’idéal, serments d’enfants, illusions, tableaux en trompe-l’œil…
Plusieurs personnages hantent ce roman : un Russe un peu bourru, un voyou attachant, un artiste excentrique obsédé par un château, un vieux montagnard au cœur tendre… Et surtout, une femme – celle de Gilles – dont la voix résonnera longtemps en nous. Tous ont un lien particulier avec celle que la presse nomme désormais la disparue de Saint-Vens.
Romancière et nouvelliste, Françoise Pirart prête aussi sa plume à ceux qui souhaitent laisser un témoignage de vie. Elle enseigne le français à des élèves d’origine étrangère à Mons en Hainaut.
En librairie le 31 mai 2018
Les premières lignes
Dans la nuit glaciale de ce début novembre, tout est calme sur l’aire d’autoroute. Monstres au repos, les camions et semi-remorques sont alignés dans l’obscurité. À l’aube, les chauffeurs quitteront leur cabine pour boire un café à la station-service et bavarder un peu avant de reprendre la route. Il n’y a pas un chat, même pas un type qui fait les cent pas pour se dégourdir les jambes après les kilomètres de bitume passés dans l’habitacle exigu. L’endroit est anonyme, désolé. On ne s’y arrête que contraint par la fatigue ou par le règlement qui astreint les routiers à prendre des pauses régulières.
La voiture roule lentement, se gare non loin des camions. C’est un break, sans doute de couleur noire, mais qui pourrait l’affirmer par une nuit aussi sombre ? À son bord, une femme. Pendant un temps, elle laisse tourner le moteur. Personne ne peut apercevoir ses gestes nerveux, la rotation de son buste quand elle se retourne pour prendre ou déposer un objet sur le siège arrière. Si le plafonnier du break était allumé, l’homme qui ne dort pas distinguerait les mouvements, les jambes fuselées, les mains pressées l’une contre l’autre. La fine silhouette s’extrait du véhicule. Portière claquée, quelques pas sur l’asphalte… La femme marche vers la station-service, sans doute va-t-elle acheter une boisson chaude. Non, elle hésite, fait demi-tour, on pourrait croire que c’est une prostituée qui tapine, mais elle est trop loin des poids lourds, et seul l’homme qui ne dort pas peut la voir se diriger vers l’arrière du bâtiment, là où se trouvent les anciens urinoirs, rendez-vous des drogués et des putains. Le camionneur insomniaque ferme les yeux. Il aimerait chuter dans un sommeil profond, mais son obsession l’entraîne, et dans sa bouche, il sent déjà le goût amer de la mort.
Élisabeth, en hiver – Michelle Fourez

Sméraldine
14 x 20,5 cm, 112 pages
ISBN 978-2-88253-545-0
EUR 12.-
Élisabeth, que le temps ne semble pas atteindre, vit à Bruxelles entre vitalité inébranlable, désespoir lancinant et solitude amie.
Ses enfants et leur famille reviennent du bout du monde pour Noël, qui du Vietnam, qui du Canada… Mais la santé de leur père, divorcé depuis longtemps de leur mère, donne des signes inquiétants.
Un huis clos riche en rebondissements, un texte dense et épuré, tout en intériorité.
Michelle Fourez vit à Tournai, où elle a enseigné pendant quarante ans les littératures française et espagnole. Grande voyageuse, elle continue d’arpenter la Terre, sac au dos. Élisabeth, en hiver est son neuvième roman.
En librairie le 3 mai 2018
Les premières lignes
Élisabeth, il faut que je te dise : j’ai refait ma vie.
Je t’embrasse,
PaulÉlisabeth est debout face à la fenêtre. Il neige, c’est décembre. Elle tient encore entre ses mains l’enveloppe qu’elle vient de déchirer à la hâte. Elle regarde encore au-dehors la neige de décembre, déjà lourde sur le houx, en bas, dans la rue. Elle pense à cette toile de Vermeer, celle où il y a aussi une femme qui tient en main une lettre, face à une fenêtre. Elle pense à cette toile longtemps, plusieurs minutes.
Maintenant, Élisabeth marche vers la cuisine. Elle ouvre la poubelle, y jette l’enveloppe déchirée et la lettre de Paul, minutieusement déchiquetée. Alors seulement elle pleure en silence, appuyée contre la table où le soleil luit sur trois oranges. Sans doute pleure-t-elle longtemps : il ne neige plus, maintenant, et la lumière au-dehors est vive. Une lumière d’après-midi de décembre.
Un autre jour, demain – Abigail Seran

Euphémie
14 x 20,5 cm, 112 pages
ISBN 978-2-88253-543-6
EUR 12.-
Déborah attend un avion qui ne vient pas une veille de Noël, espérant en secret éviter la fête. Une bande d’anciens étudiants se retrouvent pour un week-end ; sont-ils devenus ce qu’ils aspiraient à être ? Un vieux monsieur partage contre son gré un banc avec une jeune fille. Une patiente s’installe à nouveau dans une salle d’attente longuement côtoyée. La jeune Luna est trop chamboulée pour acheter un bouquet de fleurs. Il n’a pas osé leur dire qu’il ne reprendrait pas l’entreprise familiale. Le plan social était une belle opportunité. Serait-il là où il est sans cette main tendue ? Et claquent les ciseaux dans la longue chevelure !
Un autre jour, demain raconte ces points de bascule subtils ou brutaux qui construisent, transforment une existence. Autant d’histoires familiales, voyageuses, laborieuses, de brèves rencontres en récits de générations. Une galerie de personnages qui luttent, renoncent, s’animent, s’aiment, se fuient, s’éteignent, croquent la vie qui passe, celle d’aujourd’hui, celle juste avant demain.
Juriste de formation, Abigail Seran est une écrivaine suisse qui vit en Valais avec mari, ado, chien et chat. Un autre jour, demain est son premier recueil de nouvelles, après trois romans, dont Jardin d’été publié aux Éditions Luce Wilquin en 2017, et un livre de chroniques illustrées.
En librairie le 5 avril 2018
Les premières lignes
Jusqu’à se brûler la peau. Laisser l’eau. Sur la nuque, bouillante. La vapeur qui efface le reflet pour se sentir moins moche dans le miroir. Le shampoing dans les yeux. Oublier. Les autres, le monde, les contraintes, soi. Vouloir disparaître dans le siphon aux eaux sales. Peau de Sioux sous le jet agressif. Monter la température parce que le derme s’est habitué. Refuser d’arrêter. Saisir le pommeau. Passer à l’eau glacée. Ces petites entailles sur les jambes, le ventre, la poitrine, qui coupent le souffle. Et dans un geste de rage, arrêter la torture.
S’emmitoufler dans une serviette. Une silhouette trop dodue qu’on ira couvrir bien vite. Éviter le miroir tant que la transformation n’est pas achevée. Un matin comme un autre, entre abandon et espoir.
Dieu le potier et quelques autres – Françoise Houdart

Euphémie
14 x 20,5 cm, 176 pages
ISBN 978-2-88253-544-3
EUR 17.-
Douze histoires. Douze stations sur le chemin de Vie, d’amont en aval, de la source furtive à l’infini delta. Douze instants de la vie d’hommes et de femmes, héros malgré eux de leur propre histoire, saisis au vif d’un éblouissement, au reflux d’un souvenir ou dans la débâcle de la lucidité. Quelles croix de rêve et de vécu ces êtres-là ont-ils été chargés de porter sur ce chemin jusqu’au seuil de nos cœurs, dans la lumière de notre conscience, et de les y planter là, pour que nous nous reconnaissions en chacun d’eux ? Pour que leur histoire particulière se confonde à la nôtre dans les replis de notre mémoire.
Traductrice de formation et enseignante, poète, nouvelliste et romancière, Françoise Houdart tente, à travers l’écriture, d’explorer les chemins entre réalité, vraisemblance et fantasmes où marchent, se perdent, se trouvent, s’aiment ou se débattent des personnages qui nous ressemblent. Son œuvre romanesque comprend à ce jour dix-huit titres, tous publiés par les Éditions Luce Wilquin. L’auteur déploie aussi de multiples activités dans les bibliothèques et les écoles.
En librairie le 5 avril 2018
Les premières lignes
La grosse Mercedes noire s’est immobilisée dans un discret ronflement qui s’étiole aussitôt dans le silence. Temps pétrifié. L’attente plane, indécise. Soudain, venu du silence même, le bref sifflement d’un oiseau sentinelle. À l’arrière de l’automobile, un léger mouvement de la vitre teintée qui descend, lentement, devant un visage encore à-demi dissimulé dans la pénombre de l’habitacle. Puis la voix, calme elle aussi, comme épargnant son souffle :
« C’est bon, Louis. Nous attendrons quelques minutes encore. »
Combien de fois ce scénario ne s’est-il pas répété, au même lieu, à la même heure matinale, quelles que soient la saison, l’humeur du temps ou celle de la vie ? Combien de fois, attentif au moindre signe de son discret passager, partageant avec lui, jour après jour, l’émerveillement toujours renouvelé du rendez-vous avec l’étang à la frange du matin, Louis ne s’est-il pas enivré des fortes haleines de l’air pénétrant furtivement dans la voiture par la vitre baissée, odeurs fangeuses des vases croupissantes mêlées aux senteurs sauvages des terres et des herbes humides de la berge ? Ce matin, un trait folâtre d’ail sauvage se hasarde dans l’habitacle. Louis s’éclaircit la voix avant de se tourner vers son impassible passager :
« Ce sera quand Monsieur…
– Attendons encore un moment. L’eau est si calme, Louis. Si calme.
– Oui, Monsieur Rémi. Calme. Si calme…
– Et brillante. Si brillante… Ce scintillement, Louis. Mon dieu, ce scintillement !… »
Le regard du vieil homme s’envole comme s’évade un oiseau de sa cage entrouverte ; s’envole, touche, effleure la peau nacrée de l’étang ; ricoche au ras de l’eau, puis se disperse dans la gaze lumineuse de la brume matinale. La jeune lumière d’avril ébouriffe les tendres feuillages des bouleaux du pourtour en réveillant les nids. Bientôt commencera l’incessante tâche du gavage des petits et, dans les coulisses herbeuses de la rive, les vigoureuses joutes oratoires des batraciens impatients.
« Monsieur Rémi ?…
– Allons-y, Louis. Fais exactement comme d’habitude. Exactement.
– Oui, Monsieur. Exactement. »
La petite musique de Jeanne – Ethel Salducci

Sméraldine
14 x 20,5 cm, 288 pages
ISBN 978-2-88253-542-9
EUR 20.-
Si la ville de Sens en avait un pour Jeanne, ce serait la musique.
Quand elle y débarque avec deux valises et son envie d’ailleurs, la mer est loin et la maîtresse de maison arbore un air sévère, mais Jeanne sait que les cigales patientent sous terre avant de passer l’été à chanter.
«Sur l’estrade, Jeanne s’apaise, absorbée par les gestes simples. Régler le pupitre. Vérifier la coulisse du trombone. Ne pas regarder l’assistance. De toute façon, elle n’y connaît personne. Ne pas perdre de vue son objectif, partager la musique. Premier morceau. Un Caprice de Jérôme Naulais. Vibration des lèvres sur l’embouchure, le souffle s’est placé, et le staccato s’articule sans anicroche. Après une pause symbolique, poursuivre avec la réduction pour trombone de la Danse macabre de Camille Saint-Saëns. Pourquoi avoir choisi un titre aussi lugubre ? Envie de rire… Non, pas ici, pas maintenant ! Jouer, jouer et devenir musique.»
Née à Nice en 1968, Ethel Salducci a trouvé à Paris un équilibre entre chiffres et lettres. Elle a publié chez Luce Wilquin un recueil de nouvelles, Singulière Agape, qui a remporté le prix Ozoir’elles 2015. La petite musique de Jeanne est son premier roman.
En librairie le 1er mars 2018
Les premières lignes
La Signora sta poco bene. Le proviseur en personne est venu le dire aux élèves, en VO. Bref, la prof d’italien est absente. Fin des cours dès quinze heures, pas de khôlle aujourd’hui, Jeanne est libre. Elle a enfourché son vélo et chantonne. Une fille de khâgne l’a invitée samedi soir à une fête. Il y aura de la musique, des garçons. Au bout de la rue Cassini, la blancheur de l’église du port sous le soleil. Elle remonte le bas du boulevard Carnot. Sa mélodie légère flotte dans l’air. Elle rentre sa bicyclette dans le hall et grimpe les marches deux à deux jusqu’au quatrième étage. Sa mère se tient dans l’entrée, droite comme un I.
« Salut M’man !
– Jeanne… »
Sa mère hésite. Elle a vieilli. Elle n’était pas comme ça ce matin.
« Ben, t’en fais une tête !
– Jeanne, ma Jeanne, j’ai quelque chose à te dire… »
Ah, non, pas ça ! Pas de plaintes maintenant. Surtout pas de doléances contre son père. Jeanne se moque des histoires d’adultes. Il fait beau, elle n’a pas cours et la plage l’attend. Le regard de sa mère est étrange. Ses yeux sont cernés.
