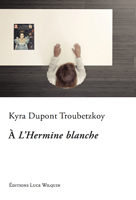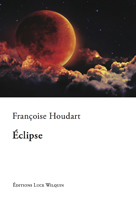Sméraldine
14 x 20,5 cm, 256 pages
ISBN 978-2-88253-537-5
EUR 20.-
Chili, 11 septembre 1973. La junte militaire renverse le gouvernement démocratiquement élu. Le président Allende se suicide dans son palais de fonction, la Moneda. Juste avant, il a confié à son jeune chargé de communication une mission secrète, qui va entraîner celui-ci sur les routes, dans les mines et dans les geôles d’un pays désormais sans espoir social. Car le Chili bascule dans l’horreur : exécutions sommaires, arrestations arbitraires, tortures… Jorge se terre durant plusieurs semaines dans la cave d’un restaurant ami, avant de tenter de prendre, sous une fausse identité, la direction de la Bolivie. Mais le meilleur policier du pays, le commissaire Ramón Gil, a été chargé de l’arrêter. Et la traque commence. D’Antofagasta au camp de concentration de Chacabuco, où il est torturé, et au désert d’Atacama, le héros va vivre une transmutation pareille à celle du cuivre, la richesse du Chili.
Les faits historiques et les anecdotes qui animent le récit sont rigoureusement réels, certains personnages ont existé.
Michel Claise est juge d’instruction, spécialisé dans la lutte contre la criminalité en col blanc. Dans son huitième roman, il a souhaité rendre hommage aux héros chiliens, mais aussi dénoncer les exactions commises par un pouvoir absolu sans respect des libertés et des droits de l’homme.
En librairie le 6 octobre 2017
Les premières lignes
Impeccablement habillé, pantalon noir repassé et veste blanche à boutons dorés garnie d’épaulettes, Edouardo, le front couvert de sueur, cherchait à se frayer un chemin parmi les convives, porteur d’un plateau garni de coupes de champagne qui s’entrechoquaient de plus belle, tant la main du serveur, pourtant aguerri, tremblait. Cela faisait deux ans qu’il avait été engagé par le señor Paulo Rosales, le gérant du plus bel hôtel Art déco de la capitale chilienne, le Careras, et son professionnalisme avait été rapidement reconnu par la direction, au point de le promouvoir comme chef de rang dans la salle des grandes réceptions. Situé au dernier étage, l’emplacement était renommé pour son immense terrasse surplombant le centre-ville, d’où la vue s’étendait jusqu’à la place de la Moneda et l’ancien palais diplomatique, que le Président Salvador Allende avait choisi comme siège de son gouvernement. Ce jour-là, rien ne se passait comme d’habitude. Son patron lui avait demandé la veille assez tard de commencer son service à neuf heures, car un client avait commandé une réception importante, et ce, curieusement, à partir de dix heures du matin. La femme d’Eduardo avait repassé son uniforme qu’il avait emporté sur un cintre. Il était pressé : il avait à peine eu le temps d’avaler un café. Dans le bus, les gens étaient nerveux, parlaient entre eux. Il se passait quelque chose de grave. Certains avaient appris par la radio tôt le matin que des troubles secouaient le pays et que des arrestations en masse étaient en cours. Mais personne n’en savait beaucoup plus. À l’arrêt Plaza de Armas, le bus s’était vidé. À peine descendu, comme les autres usagers, Edouardo avait sursauté : ils entendaient au loin comme des coups de feu. Les travailleurs matinaux avaient été, comme lui, surpris par le claquement de détonations toutes proches. Un passant leur avait crié que l’armée montait à l’assaut du palais présidentiel. Un autre avait confirmé que c’était un coup d’État. Edouardo, sous le choc, avait hésité un instant : il eût été plus prudent de faire demi-tour. Mais son travail était trop important pour lui et sa famille. Et puis, un ordre du patron, ça ne se discutait pas.