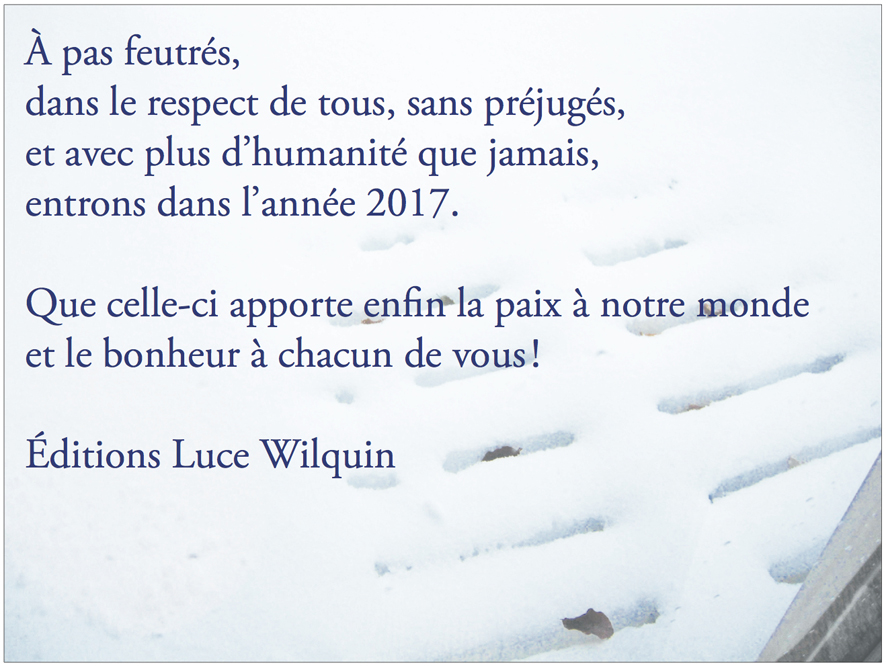Sméraldine
14 x 20,5 cm, 208 pages
ISBN 978-2-88253-532-0
EUR 20.-
Élé et Charles, couple de jeunes retraités, accueillent leurs petits-enfants pour un mois de vacances. Pour la première fois, ils sont tous là, les jumeaux londoniens John et June et Iris, la fille d’Agathe, mère angoissée à l’idée de laisser son enfant chez ses parents.
Une famille, comme un mobile, maintenue en harmonie grâce au rôle et à la position de chacun. Alors, quand au cœur de cet été bourguignon le passé refait surface, le fragile équilibre est mis à mal.
Ce roman polyphonique suit cette tribu un mois de juillet pas comme les autres. Celui où les non-dits se lèvent et où l’histoire personnelle de chacun se révèle, se transforme à la lumière d’une donnée trop longtemps escamotée.
Après plus de vingt ans passés à vadrouiller en Suisse Romande et à l’étranger, Abigail Seran, aussi juriste et enseignante, a posé ses valises avec mari et enfant dans son Valais natal. Jardin d’été est son troisième roman après Marine et Lila (2013) et Une maison jaune (2015). Elle est également l’auteur d’un livre de chroniques illustrées (2015) et de textes publiés dans différentes revues.
En librairie le 21 avril 2017
Les premières lignes
« Je te rappelle qu’on ne pouvait pas faire autrement. »
Le gravier crissait sous les pneus. Cette allée était toujours sans fin. Le temps de se dire les dernières phrases avant le sourire de circonstance.
« Je me demande de quelle couleur sont ses cheveux cette année ? »
Cela eut pour effet de dérider un peu Agathe. Les cheveux de sa mère, une plaisanterie familiale, une manière pour son mari d’enterrer la hache de guerre.
« Allez ! Je parie pour le turquoise. »
Du coin de l’œil, Florent vit qu’il avait fait mouche. Elle avait souri.
« Moi, je dis vert, on n’a pas encore eu, vert.
– Tu es réveillée, toi ? »
Agathe se tourna vers sa fille. Iris se réveillait toujours au moment où les petits cailloux du chemin chaotique venaient frapper la carrosserie. Elle adorait l’endroit autant que sa mère le redoutait.
« Tu crois que les J sont déjà là ? »
June et John, Agathe les avait presque oubliés dans la précipitation à trouver en urgence une solution de garde pour Iris en ce mois de juillet.
« Je ne sais plus si Élé m’a dit qu’ils arrivaient un jour avant ou un jour après toi.
– Je me réjouis, je me réjouis, mais je me réjouis tellement ! »
Iris, malgré ses yeux embrumés de sommeil, avait sur le visage la joie d’un enfant qui découvre les cadeaux de Noël sous le sapin. Agathe en eut le cœur serré.